De la résistance à la victoire
- Tom Vermolen

- 19 sept. 2025
- 7 min de lecture
CIJ 2025 La victoire d’un mouvement, l’espoir d’une planète
By Atrayee
La reconnaissance historique de la justice climatique
L’avis consultatif de la Cour internationale de justice marque une victoire historique pour les militants du climat ! Il reconnaît officiellement le changement climatique comme une « menace existentielle » en droit international. Depuis des décennies, les défenseurs du climat affirment sans détour que le changement climatique relève de la justice et de la survie, et pas seulement de l’environnement. La décision de la Cour internationale de justice vient confirmer cette position et offre aux militants un outil puissant pour affirmer que les gouvernements ont des obligations juridiques — et pas seulement des choix politiques — pour lutter contre le changement climatique.

Le chemin vers la Cour
Un nombre record de 91 mémoires ont été déposés, accompagnés de 62 contributions supplémentaires sans précédent — des dépôts additionnels ou en réponse, visant à traiter des arguments soulevés par d’autres parties.
En 2019, la campagne a débuté avec 27 étudiants de l’Université du Pacifique Sud, qui cherchaient à convaincre les dirigeants du Forum des îles du Pacifique. Le PISFCC (Pacific Island Students Fighting Climate Change) s’est ensuite associé, l’année suivante, à des jeunes d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et d’Europe sous la bannière des World’s Youth for Climate Justice (WYCJ). Le gouvernement du Vanuatu a alors déclaré son intention de mener l’initiative en faveur d’un « avis consultatif » de la CIJ sur les responsabilités des États concernant le changement climatique et les droits humains. Après trois séries de consultations avec d’autres États, la résolution a été présentée à l’Assemblée générale de l’ONU avec le soutien de 105 pays co-parrains.
SIX aspects déterminants
Renforcer la responsabilité juridique
L’avis précise que les États peuvent être tenus pour responsables, en droit international, de leurs émissions nocives et de leurs manquements à agir. Cela élève le niveau d’exigence en matière de responsabilité, au-delà des promesses politiques, et fait de l’inaction climatique une possible violation du droit.
Donner du pouvoir aux États vulnérables
Les petits États insulaires en développement (PEID) et les régions touchées par le climat acquièrent une assise juridique renforcée pour exiger des actions, des réparations ou une coopération de la part des grands pays pollueurs qui menacent leur survie.
Reconnaissance de la dimension des droits humains
En reliant le changement climatique au droit des droits humains, l’avis affirme que les États doivent protéger les droits fondamentaux — tels que la vie, la santé, l’accès à une eau salubre et la sécurité alimentaire — lorsqu’ils s’attaquent aux impacts du changement climatique.
Influence sur les juridictions et politiques nationales
Même si l’avis est consultatif, les juridictions nationales et régionales peuvent s’y appuyer pour renforcer le contentieux climatique, contribuant ainsi à façonner des lois et politiques internes plus strictes contre les émissions nocives.
Autorité morale et normative
La voix de la CIJ a une portée mondiale. Cet arrêt renforce les récits autour de la justice climatique, soutient les campagnes des militants et oblige les gouvernements à s’aligner sur les normes internationales.
Catalyseur de la coopération internationale
L’avis met en avant les obligations collectives inscrites dans des traités comme l’Accord de Paris, incitant les États à coopérer, à agir avec équité et à partager la responsabilité face à la crise climatique.
1,5 °C comme référence juridique
Une victoire majeure réside dans la manière dont la CIJ traite le seuil de réchauffement de 1,5 °C. La Cour considère que « …le seuil de 1,5 °C constitue l’objectif principal convenu par les parties pour limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale dans le cadre de l’Accord de Paris. »
Pour les communautés en première ligne et les militants, ce n’est pas un objectif ambitieux ou lointain, mais une ligne de survie. En réaffirmant que le 1,5 °C est à la fois une nécessité scientifique et une obligation juridique, la Cour renforce les arguments contre l’expansion des énergies fossiles et contre des objectifs climatiques trop faibles.

L’inaction considérée comme une faute : un nouveau levier juridique
Un point crucial pour les militants est la reconnaissance par la Cour que les actes illicites incluent aussi les omissions. Subventionner les énergies fossiles, autoriser de nouveaux champs pétroliers ou ne pas encadrer les acteurs privés ne sont pas des choix neutres — ce sont des manquements délibérés à une obligation légale. Cela rejoint l’argument des militants selon lequel retarder l’action revient à se rendre complice. En qualifiant juridiquement l’inaction d’acte fautif, la CIJ offre aux campagnes climatiques un langage plus percutant pour interpeller les gouvernements et les entreprises qui freinent les avancées.

La CIJ a affirmé que les États pouvaient être tenus responsables du changement climatique, rejetant l’argument selon lequel les émissions de gaz à effet de serre seraient trop diffuses pour être attribuées à une pollution localisée. Elle a souligné que la responsabilité ne découle pas seulement des émissions directes, mais aussi des omissions et des politiques qui favorisent activement l’usage des énergies fossiles, établissant ainsi un lien juridique clair entre l’action des États et les dommages climatiques mondiaux.
L’arme juridique des tribunaux nationaux
La CIJ fournit une autorité juridique qui peut être mobilisée devant les tribunaux nationaux, dans les négociations internationales et dans les campagnes publiques. En fixant des normes claires de responsabilité et d’obligation, cet avis devient une boussole pour le mouvement climatique mondial.
L’objectif d’un avis consultatif de la CIJ est de clarifier le sens, la portée ou l’application du droit international dans une situation donnée. Contrairement aux affaires contentieuses, les avis consultatifs ne sont pas contraignants — ils ne tranchent pas de litiges ni n’imposent d’obligations — mais ils possèdent une forte autorité et influencent la manière dont les États et les tribunaux interprètent le droit.

Les DEUX questions centrales
Question (a): Les obligations des Etats
Que doivent faire les pays, en vertu du droit international, pour protéger le climat contre les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine, non seulement pour les populations d’aujourd’hui mais aussi pour les générations futures ?
Question (b): Les conséquences juridiques des dommages
Si les pays ne respectent pas leurs obligations et, par leurs actions ou leurs omissions, causent de graves dommages au climat et à l’environnement, quelles conséquences juridiques doivent-ils encourir ?
Outils juridiques pour les régions vulnérables
A: Les communautés africaines
Des pays comme la Somalie, le Soudan et les États du Sahel sont confrontés à l’aggravation des sécheresses, à la désertification et aux conflits liés à la rareté des ressources — des menaces qui fragilisent encore davantage des structures de gouvernance déjà précaires. Cette reconnaissance offre aux communautés africaines un appui juridique pour revendiquer à la fois résilience et justice.
B: L’Asie du Sud
Les nations les plus vulnérables au climat, dont le Bangladesh, le Népal et les zones côtières de l’Inde situées en basse altitude, sont particulièrement exposées. Dans ces régions, les inondations, les cyclones et la fonte des glaciers menacent des millions de personnes, entraînant souvent le déplacement des populations les plus pauvres et marginalisées. L’avis de la CIJ renforce la position des mouvements locaux qui luttent contre l’expansion incontrôlée du charbon en Inde ou contre l’insuffisance des mesures d’adaptation au Bangladesh, en permettant d’affirmer que ces manquements ne sont pas de simples lacunes politiques, mais bien des actes internationalement illicites.
C: L’Amérique latine
La forêt amazonienne — un puits de carbone essentiel — est menacée par la déforestation, les industries extractives et la militarisation des terres autochtones. Les communautés du Brésil, du Pérou et de la Colombie peuvent désormais qualifier la déforestation et la négligence des États d’actes internationalement illicites compromettant la stabilité climatique mondiale. Dans l’Arctique, la fonte des glaces accélère la montée du niveau de la mer et dévaste les moyens de subsistance des populations autochtones ; la reconnaissance par la Cour des droits intergénérationnels renforce les revendications des peuples arctiques en faveur d’une protection et d’une adaptation urgentes. Ces régions, bien que diverses, partagent un même combat : leur survie dépend de la capacité à tenir les entreprises et les États puissants responsables en vertu du droit international.

D: Les nations insulaires du Pacifique contre les États à fortes émissions
Depuis des décennies, de petits États insulaires comme Tuvalu, Kiribati et les îles Marshall perdent des terres, des sources d’eau douce et une partie de leur patrimoine culturel à cause de la montée des eaux provoquée par les émissions industrielles des pays développés. Dans ce nouveau cadre juridique, l’inaction des États à fortes émissions pour réduire leurs rejets pourrait être considérée comme un acte illicite, rendant ainsi légitimes sur le plan légal des réparations telles que le soutien financier, l’aide à la relocalisation ou les fonds d’adaptation.
Réaction de la communauté pour la justice climatique
Vishal Prashad, directeur de Pacific Islands Students Fighting Climate Change, a salué l’avis consultatif en déclarant :
« Pour les petits États insulaires, les communautés du Pacifique, les jeunes et les générations futures, cet avis est une bouée de sauvetage et une occasion de protéger ce qui nous est cher et que nous aimons. Je suis désormais convaincu qu’il y a de l’espoir et que nous pouvons retourner dans nos communautés en tenant le même discours. Aujourd’hui est un jour historique pour la justice climatique et nous sommes un pas plus près de la concrétiser. »
L’avis de la CIJ constitue une victoire car il valide les revendications des militants, renforce les outils juridiques et redéfinit le changement climatique comme une question de devoir, et non de simple choix politique. En reconnaissant le seuil de 1,5 °C comme contraignant, en qualifiant les omissions d’actes fautifs et en mettant en lumière la vulnérabilité des communautés touchées, la Cour donne plus de pouvoir aux mouvements du monde entier. Bien qu’il ne soit pas directement contraignant, son poids normatif offre aux militants pour le climat un levier inédit pour tenir les États responsables et promouvoir un avenir juste et durable.
Note :
Vous pouvez télécharger le texte intégral en français de l’avis consultatif sur le site de la CIJ, au format PDF.








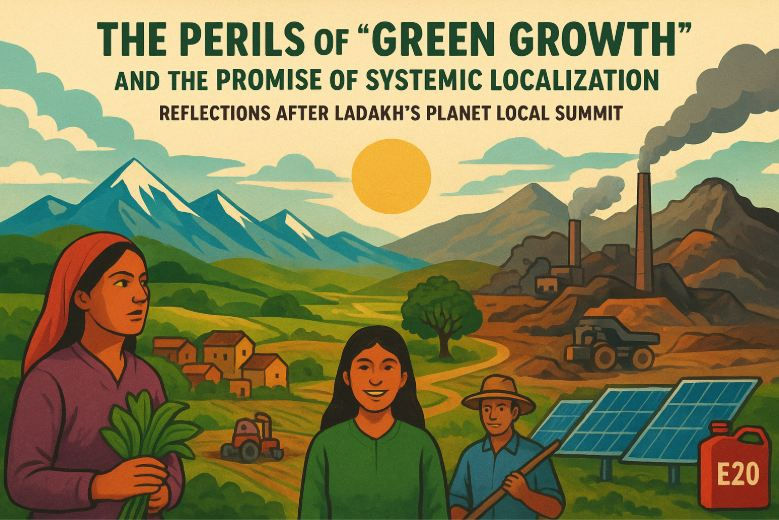
Commentaires