Désarmement et justice climatique
- Tom Vermolen

- 18 sept. 2025
- 10 min de lecture
les deux faces d'une même pièce de monnaieles
Akhar Bandyopadhyay

Aujourd'hui, les militants pour le climat sont de plus en plus confrontés à un dilemme
crucial : faut-il se concentrer exclusivement sur les questions climatiques en tant que préoccupations isolées ou aborder également les injustices sociopolitiques plus larges qui sont étroitement liées à la dégradation de l'environnement
(et pas uniquement au « climat ») ?
Pourtant, ces luttes sont indissociables.
La guerre contre la nature et la guerre contre les populations découlent, toutes deux, de la même volonté extractiviste illogique. En réfléchissant aux idées partagées par Satish Kumar lors d'un cours au Schumacher College auquel j'ai eu le privilège d'assister en juillet 2025, il apparaît clairement que cette absence de logique est enracinée dans une mentalité systémique, militarisée et industrielle. Ainsi, la paix ne peut pas se comprendre comme la simple absence de guerre ; elle doit plutôt représenter une vision holistique qui favorise l'épanouissement de toute vie en profonde harmonie avec la nature.
I. Géopolitique des ressources : la guerre comme moyen de contrôle
La guerre sert souvent d'outil pour consolider le contrôle des ressources naturelles, qui sont considérées comme une simple ressource économique parmi d'autres.
En Ukraine, l'épicentre oriental du conflit abrite du charbon, du gaz, du fer, des métaux rares et un sol fertile de belle couleur noire. L'Ukraine exporte d'importantes quantités de blé et de maïs, ce qui en fait un maillon essentiel des réseaux de ressources du capital mondial.
L'occupation forcée de la Palestine par Israël lui permet d'usurper le contrôle de l'eau et des terres. En Cisjordanie, Israël détourne 80 à 90 % des ressources en eau. À Gaza, 96 à 97 % de l'eau est impropre à la consommation, et les bombardements ont produit 23 à 40 millions de tonnes de décombres toxiques. Les gisements de gaz naturel de Gaza restent inaccessibles. Comme le souligne Vandana Shiva, ces actes constituent un « apartheid environnemental », reliant la résistance palestinienne au mouvement plus large pour la justice climatique.
Inde : zones « maoïstes » ou couloirs d'extraction ?
Bon nombre des zones dites « maoïstes » de l'Inde, situées dans les États du Chhattisgarh, du Jharkhand, de l'Odisha, du Telangana et de l'Andhra Pradesh, recoupent des forêts riches en bauxite, en charbon, en minerai de fer et en uranium. Ces régions sont censées être marquées par une « insurrection armée » entraînant la violence étatique, mais elles sont également signalées comme des sites suscitant un vif intérêt de la part des entreprises minières.
Cela soulève une question urgente : ces zones sont-elles intrinsèquement sujettes aux conflits, ou bien sont-elles délibérément maintenues dans l’instabilité afin de faciliter l’extraction ?
Lorsque les communautés autochtones résistent à leur déplacement, l'État invoque souvent la « sécurité nationale » pour justifier la militarisation, ce qui conduit à la surveillance et à la répression. Il en résulte une contre-insurrection écologique, où l'exploitation minière se poursuit tandis que les droits fonciers reculent.
Voici quelques exemples frappants :
Dantewada et Bastar (Chhattisgarh) : riches en minerais et au cœur de l'opération Green Hunt, des entreprises telles qu'Essar et Tata détiennent des intérêts miniers. Les villageois qui résistent à leur déplacement sont victimes de violentes répressions.
Kalinganagar (Odisha) : riche en chromite et en minerai de fer, 13 autochtones ont été tués en 2006 alors qu'ils manifestaient contre une usine Tata Steel. La présence dite « maoïste » s'est intensifiée après les violences étatiques.
Niyamgiri Hills (Odisha) : le mouvement Dongria Kondh s'est opposé aux projets d'exploitation de bauxite de Vedanta, défendant l'esprit sacré de la terre. L'État a fait croire qu'il existait des liens avec les « maoïstes », peut-être pour délégitimer leur résistance.
Singhbhum (Jharkhand) : riche en uranium et en cuivre, cette région est souvent qualifiée de zone « maoïste ». Les répressions de l'État coïncident souvent avec l'empiètement des entreprises. À Jadugoda, des décennies d'exploitation minière par l'Uranium Corporation of India Limited (UCIL) ont laissé les familles autochtones avec des malformations congénitales, des cancers, un sol et une eau empoisonnés, mais les villageois et plusieurs groupes militants qui exigent des comptes sont qualifiés d'insurgés.
Dans chaque région, assistons-nous à une insurrection armée ou à une stratégie visant à déplacer les populations en qualifiant la résistance d'extrémisme, tandis que les intérêts des entreprises se poursuivent sans contrôle ?
On observe une situation similaire dans le projet d'autoroute Char Dham dans l'Uttarakhand, déjà achevé à 75 % (en 2024). Présenté comme un moyen d'améliorer les pèlerinages et la connectivité frontalière, ce corridor de 900 km facilite manifestement les mouvements de troupes près de la Chine. Le projet provoque actuellement des répercussions écologiques massives : déforestation de plus de 40 000 hectares, pollution de l'eau et des sols, dégradation des terres agricoles, déplacements de populations et destruction de communautés autochtones.
Le projet entraîne actuellement des conséquences écologiques désastreuses : la déforestation de plus de 40 000 arbres a accru les risques de glissements de terrain et d'inondations, dont une qui sévit actuellement à Uttarkashi. Comme dans les « zones maoïstes », ce projet révèle comment la militarisation et les intérêts des entreprises déplacent des communautés et endommagent de manière irréversible les écosystèmes, sous le couvert d'un discours de « développement » qui relève du lavage de cerveau.
II. La guerre, facteur d'émissions
Les guerres contemporaines contribuent massivement au réchauffement climatique. À elle seule, la guerre en Ukraine a libéré plus de 230 MtCO₂e, soit l'équivalent des émissions combinées de l'Autriche, de la Hongrie, de la République tchèque et de la Slovaquie. En Palestine, 1,9 MtCO₂e ont été émises, et la reconstruction devrait ajouter 30 à 31 MtCO₂e, soit plus que les émissions annuelles d'environ 135 pays.
Les activités militaires entraînent la destruction de l'environnement de multiples façons : par l'utilisation d'explosifs et les incendies industriels qui libèrent des polluants nocifs ; l'effondrement des infrastructures qui disperse des matières toxiques dans les écosystèmes ; l'exposition prolongée à des produits chimiques dangereux provenant des munitions et des opérations militaires ; et la relance des centrales électriques à combustibles fossiles en Europe, déclenchée par les perturbations énergétiques liées aux conflits, et la résurgence des centrales électriques à combustibles fossiles en Europe, déclenchée par les perturbations énergétiques dues au conflit, ce qui sape des engagements climatiques essentiels.
III. Budgets consacrés à la destruction contre budgets consacrés à la préservation
Un coup d'œil aux budgets mondiaux révèle un déséquilibre inquiétant :


Dépenses militaires mondiales (2024) : environ 2 700 milliards de dollars (environ)
Financement mondial pour le climat (2021) : environ 850 milliards de dollars (environ), bien en dessous de l'objectif de 4 300 milliards de dollars par an fixé par le GIEC pour atteindre l'objectif de 1,5 °C.
Cela révèle une « civilisation » autodestructrice, axée sur l'endettement et le consumérisme, qui privilégie la destruction plutôt que la régénération.
IV. L'empreinte carbone des forces armées
Les forces armées sont exemptées des obligations de déclaration des émissions prévues par l'accord de Paris. Cela leur permet de soustraire leur empreinte carbone massive à tout contrôle.
Le département américain de la Défense est le plus grand consommateur mondial de combustibles fossiles ; s'il était classé comme un pays, ses émissions dépasseraient celles de 140 autres pays.
Les opérations militaires, la production d'armes et les infrastructures (acier, ciment, kérosène) génèrent des émissions de scope 3 non comptabilisées.
Le militarisme est l'émetteur le plus dérégulé de la planète. La justice climatique doit abolir cette exception militaire.
V. Le complexe militaro-industriel-fossile : l'économie techno-guerrière
Les fabricants d'armes tels que Lockheed Martin et Raytheon tirent profit à la fois de la guerre et des opérations de sécurité liées aux combustibles fossiles. Les compagnies pétrolières, quant à elles, exigent une protection militaire pour leurs pipelines et leurs plateformes, en particulier dans ce qu'on appelle le « Sud global », soit la majeure partie de la planète.
Cela crée un cercle vicieux : la protection militaire alimente l'extraction fossile, et l'extraction fossile finance le militarisme.
Les marchés boursiers récompensent cette stratégie : rien que pendant le conflit en Ukraine, les actions de Lockheed Martin ont augmenté de 18 %, celles de Northrop Grumman de 22 % et celles de RTX de 8 % — des profits réalisés grâce à la souffrance humaine et à la destruction de l'environnement.
Le pétro-capitalisme évolue désormais vers un extractivisme pseudo-vert (ou « green-extract-washing »). Au nom de la transition énergétique, les États se disputent le lithium, le cobalt et les métaux rares, souvent au détriment des communautés autochtones.
La Critical Minerals Mission indienne, menée par l'Indian Institute of Technologies (IIT) et des consortiums privés, accélère cette tendance en pratiquant une exploitation minière dans des zones autochtones écologiquement sensibles, sans le consentement collectif. Il s'agit là d'un colonialisme climatique sous une nouvelle bannière.
Si on n’a pas la vision de la planète entière, la transition verte risque de devenir une nouvelle source de violence écologique.
VI. Conflits induits par le climat et risque d'éco-fascisme
Le militarisme ne provoque pas seulement la dégradation du climat, il est également présenté comme une adaptation au dérèglement climatique :
Les déplacements induits par le climat (1,2 milliard de personnes d'ici 2050 : estimation minorée des chiffres du GIEC !) conduisent à la militarisation des frontières aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Australie.
Les discours sur la « sécurité climatique » et l'« éco-nationalisme » gagnent du terrain, favorisant un contrôle géopolitique xénophobe des frontières sur une planète par ailleurs sans frontières.
Les idéologies d'extrême droite se tournent vers l'éco-fascisme, plaidant pour la préservation des patries contre les « migrants climatiques ».
L'effondrement climatique n'est pas seulement écologique, il est profondément politique. Les réponses militarisées aux crises écologiques risquent d'accélérer les tendances totalitaires.
VII. La pacification par la base comme solution climatique
Les propositions autochtones offrent des alternatives systémiques. Elles rejettent à la fois l'extractivisme et le militarisme, mettant l'accent sur la convivialité non violente, la réciprocité et la réparation.
Parmi les exemples qui inspirent la résistance contemporaine, on peut citer :
La résistance des Dongria Kondh
Le zapatisme au Chiapas
Les actions du Buen Vivir en Amérique latine
La Via Campesina
Le MAPA et la Climate Justice Alliance, etc.
Ces mouvements privilégient la vie en communauté et la convivialité écologique. D'autre part, les émissions militaires ne sont toujours pas abordées dans les « conférences sur le climat » des élites, et le financement climatique est soit retardé, soit marchandé. Les solutions véritablement porteuses de changement ne se trouvent pas dans les salles de négociation des élites, mais dans les luttes locales de première ligne et les résistances vécues. La justice climatique doit être anticolonialiste, antipatriarcale et antimilitariste. Le carbone, à lui seul, n’est pas l’ennemi : c’est la violence structurelle qui l’est.
VIII. Conclusion : un avenir abolitionniste
En nous inspirant des mouvements abolitionnistes contre les prisons et la police, nous devons envisager l'abolition de l'armée comme une voie vers la réparation écologique.
Cela implique :
De réorienter les budgets militaires vers l'adaptation, l'agroécologie, les secours en cas de catastrophe et la restauration écologique.
De réaffecter les technologies militaires à des travaux constructifs porteurs de vie, par exemple utiliser des drones pour le réensauvagement ou la logistique pour l’aide climatique.
De permettre aux soldats de devenir paysagistes, coordinateurs des interventions en cas de catastrophe ou praticiens de la permaculture.
Ce n'est pas une utopie, c'est une nécessité planétaire.
Les chars qui rasent les villes procèdent de la même logique que celle qui rase les forêts. Les avions de chasse qui survolent Gaza et Kiev consomment les mêmes combustibles fossiles qui font fondre les glaciers et empoisonnent l'air. Le modèle systémique qui exploite les animaux dans les élevages industriels et impose la violence de la monoculture dans les champs est le même que celui qui engendre des cycles sans fin d'endettement dans les « pays du Sud » en fabriquant des contradictions conflictuelles dans le cadre du programme pré-endettement (sic) de la Banque Mondiale, du FMI et de l'OMC. Les banques alimentent cette machinerie en blanchissant l'argent provenant des ventes d'armes, du pillage des ressources et des trafics illicites, déguisant ainsi des capitaux maculés de sang en flux d'investissement légitimes. La guerre devient ainsi la recette fast-food du complexe militaro-industriel, se perpétuant sans relâche malgré sa mission intrinsèquement suicidaire.
Le désarmement complet (général et entier) n'est pas une diversion, il est au cœur de la justice climatique et environnementale.
Nous devons nous organiser pour un monde où les seules armes que nous devons brandir sont celles de la solidarité et de la compassion, et non celles de la guerre. Désarmons la planète ! Fermons les usines d'armes, maintenant !
Post-scriptum : L'Afrique appelle
Partout en Afrique, les militants pour le climat s'unissent pour réclamer :
Une réduction des dépenses militaires,
Une réaffectation des fonds en faveur de la justice climatique,
Des sommets démilitarisés sur le climat.
Leur message est clair : il ne peut y avoir de justice climatique sans paix. Il est grand temps d'écouter et d'agir.
Signez la pétition : Paix, climat, justice – L'Afrique appelle
Références
Satish Kumar and Schumacher College
Kumar, S. (2013). Soil, Soul, Society: A New Trinity for Our Time. Leaping Hare Press.
Author’s reflections from Schumacher College Foundation Course, July 2025.
Guerre d’Ukraine et Ressources naturelles
U.S. Geological Survey. (2020). Mineral Commodity Summaries 2020.
FAO. (2022). Ukraine: Soil and Agriculture Overview.
World Bank Reports on Black Soil and Agricultural Exports.
Israel-Palestine : gestion de ressource et impacts sur l’environnement
UNEP. (2024). Environmental Impact of the Conflict in Gaza.
WHO. (2023). Water and Sanitation Standards.
Amnesty International. (2023). Israel’s Occupation: Water Access in the West Bank and Gaza.
Al-Haq & Forensic Architecture. (2024). Ecocide in Gaza: Environmental Destruction and Conflict.
En Inde, extractivisme et « zones maoïstes »
Padel, F., & Das, S. (2010). Out of This Earth: East India Adivasis and the Aluminium Cartel. Orient BlackSwan.
Human Rights Watch. (2010). What Did We Get for It? Mining and Human Rights in Chhattisgarh.
Survival International. (2013). The Dongria Kondh’s Victory at Niyamgiri.
MoEFCC. (2024). Annual Report 2023–24. Government of India.
Char Dham : projet d’autoroute
Ministry of Road Transport and Highways. (2024). Char Dham Pariyojana Progress Report.
Down to Earth Magazine. (2024). Char Dham Project: Environmental Costs and Landslides.
Empreinte climatique des guerres
Igini, M. (2023). The Carbon Footprint of the War in Ukraine. Earth.Org.
Scientists for Global Responsibility. (2024). Military Emissions in the Ukraine Conflict.
Militarisation mondiale et budgets climatiques
SIPRI. (2024). World Military Expenditure 2024.
IISS. (2024). The Military Balance 2024.
OECD. (2023). Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries.
IPCC. (2022). Sixth Assessment Report: Mitigation of Climate Change.
Sauer, Pjotr. “‘We’re the canary in the coalmine’: When will Russia take action on the Climate?” The Guardian, 18 July 2025.
Once in a Blue Moon Academia. “Fortifying India: Reading Between the Lines of the 2025 Defence Budget.” 12 August 2025.
Once in a Blue Moon Academia. “Shut Down Arms Factories to Stop Wars: Dismantling the Global War Profiteering Machine.” 23 August 2025.
Militarisation mondiale et empreinte carbone
Crawford, N. C. (2019). Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War. Watson Institute, Brown University.
Belcher, O., et al. (2020). Hidden Carbon Costs of the Everywhere War. Transactions of the Institute of British Geographers, 45(1), 65–80.
Conflits liés au climat et éco-fascisme
IOM. (2021). World Migration Report: Climate Displacement Projections.
Selby, J., & Hoffmann, C. (2022). Rethinking Climate Security: Beyond the Conflict Frame. Climate Policy Journal.
Mouvements autochtones et populaires pour la justice climatique
La Via Campesina. (2023). Peasant Agroecology for Climate Justice.
Climate Justice Alliance. (2024). Just Transition Framework.
Esteva, G., & Prakash, M. S. (1998). Grassroots Postmodernism: Remaking the Soil of Cultures. Zed Books.








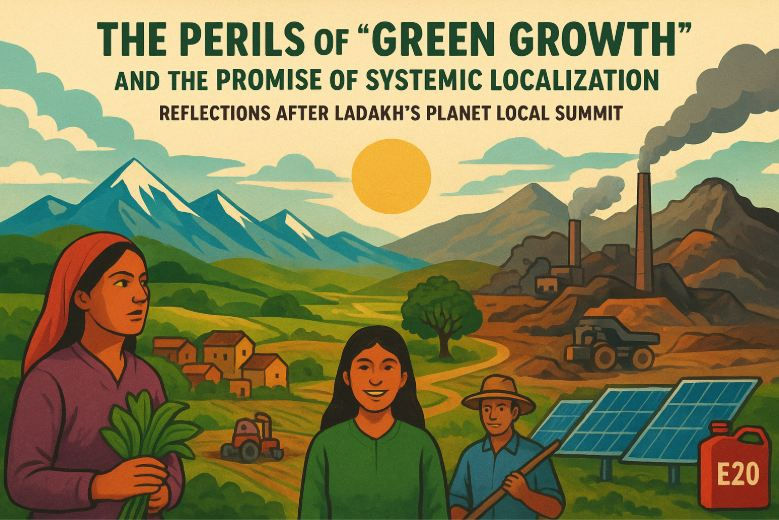
Commentaires