Une seule planète, une seule crise
- Tom Vermolen

- 15 août 2025
- 11 min de lecture
Dernière mise à jour : 17 août 2025
Atrayee Basu, 3 Aout 2025
1. Texas : la ville qui ne pouvait pas dormir
L'air à Austin, au Texas, était lourd comme une épaisse couverture imbibée d'essence. Même à minuit, le thermomètre à l'extérieur de l'appartement de Javier indiquait 37 °C. Le sommeil était devenu un luxe. Les nuits n'étaient plus un répit frais après la chaleur torride de la journée, mais une prolongation de sa fureur.
Javier, ambulancier paramédical, essuyait la sueur de son front, assis sur les marches de l'aire de stationnement des ambulances des urgences. Nous étions en juin 2025, et le Texas subissait sa troisième semaine consécutive de chaleur extrême. Le gouverneur avait qualifié cette situation de « canicule historique », mais les habitants en avaient assez des euphémismes.
À l'intérieur des urgences, les cas de coups de chaleur affluaient : des patients âgés souffrant d'insuffisance cardiaque, des enfants victimes de convulsions, des travailleurs en extérieur s'effondrant en plein service. Les réseaux électriques grinçaient sous le poids des climatiseurs et des coupures de courant généralisées avaient commencé.
« Chaque été semble pire que le précédent », marmonna Javier en buvant une gorgée d'eau tiède. Il n'avait pas tort. Les climatologues avaient prévenu que le jet stream s'affaiblissait, bloquant les systèmes météorologiques et maintenant les dômes de chaleur en place. Ce qui était autrefois une vague de chaleur passagère était devenu une cocotte-minute stationnaire.
Puis vint l'inondation. Début juillet 2025, les restes d'humidité tropicale entrèrent en collision avec la terre surchauffée, déclenchant l'inondation catastrophique du centre du Texas. Le fleuve Guadalupe passa de 2 mètres à près de 10 mètres, submergeant des kilomètres carrés de terres agricoles et forçant les autorités à évacuer des milliers de personnes.

Ces extrêmes – chaleur mortelle suivie de pluies torrentielles – n'étaient pas une coïncidence. L'air plus chaud retient plus d'humidité, ce qui entraîne des déluges soudains lorsqu'il pleut. Le dôme de chaleur de 2023 qui a brûlé le Texas était 150 fois plus probable en raison du changement climatique.
Le Texas continue de résister à une politique climatique coordonnée. Les rachats de plaines inondables, les infrastructures intelligentes et les plans d'adaptation à l'échelle de l'État restent sous-financés ou ignorés.
2. L'Europe : un continent en feu
De l'autre côté de l'Atlantique, à Marseille, en France, Adèle transpirait pendant une nouvelle nuit agitée. La France, l'Italie et l'Espagne avaient battu des records de température, une fois de plus. Le sud de l'Europe était en train de devenir un nouveau Sahara.
Sa grand-mère de 76 ans, autrefois ouvrière dans les vignes, était assise et s'éventait avec un vieux journal. « Cette terre était destinée à la lavande, pas aux incendies », disait-elle avec amertume.
Les incendies avaient ravagé des milliers d'hectares dans le sud de la France. Les vignobles se flétrissaient. Les récoltes d'olives avaient chuté. Le tourisme s'était effondré, non pas parce que les gens avaient cessé de venir, mais parce qu'ils ne pouvaient supporter une telle chaleur. Les infrastructures urbaines craquaient sous la pression. Les trains patinaient sur les rails. Les vacances scolaires avaient commencé plus tôt que prévu en raison de l'inhabitabilité des salles de classe. Les personnes âgées mouraient en silence, beaucoup d'entre elles sans climatisation.
Aux Pays-Bas, un pays historiquement marqué par sa lutte contre l'eau, un nouvel ennemi fait son apparition : la chaleur. Dans des villes comme Maastricht, les relevés quotidiens de température ont montré une nette tendance à la hausse au cours du siècle dernier. Autrefois rares, les journées à plus de 35 °C sont désormais fréquentes, même dans les zones tempérées du nord de l'Europe. Cette tendance au réchauffement pose des risques pour la santé, en particulier pour les personnes âgées et celles qui n'ont pas accès à la climatisation. Dans le même temps, les Pays-Bas sont confrontés à des défis croissants liés à l'élévation du niveau de la mer. Une grande partie du pays se trouve sous le niveau de la mer et est protégée par un système complexe de digues, de pompes et de barrières anti-tempête. Mais l'élévation du niveau des océans et l'intensification des précipitations mettent ce système à rude épreuve. Les ingénieurs néerlandais sont désormais à la pointe des stratégies d'adaptation mondiales grâce à des innovations telles que « Room for the River », qui permet aux plaines inondables d'absorber l'excès d'eau. Cependant, si le réchauffement dépasse 1,5 °C, les émissions continues menacent de dépasser même les défenses les plus avancées.

Adèle a consulté son application météo : 43 °C prévus pour demain. « Ce n'est pas l'été », a-t-elle envoyé par SMS à sa cousine en Allemagne. « C'est une punition. » L'Europe se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Même en Allemagne et aux Pays-Bas, autrefois considérés comme « sûrs », les décès liés à la chaleur sont en augmentation. Les réfugiés climatiques en Europe sont désormais une réalité. Malgré le Pacte vert européen, les critiques avertissent que les budgets carbone ne sont pas alignés sur les objectifs de 1,5 °C.
3. Inde : l'arrivée des eaux
L'Inde, qui compte plus de 1,4 milliard d'habitants, est de plus en plus confrontée à de multiples catastrophes climatiques.
Ces dernières années, le pays a connu des vagues de chaleur sans précédent, des moussons irrégulières, des crues soudaines et une élévation du niveau de la mer, tous ces phénomènes s'intensifiant sous l'effet du réchauffement climatique. Les conséquences se font sentir non seulement dans les villes, mais aussi dans les villages ruraux, les ceintures agricoles et les régions montagneuses.
L'Inde a été confrontée à des conditions météorologiques extrêmes sur plusieurs fronts. En 2022, une vague de chaleur printanière historique dans le nord-ouest de l'Inde et au Pakistan a détruit 15 à 30 % des récoltes de blé. En 2025, les tempêtes de mousson dans l'Assam et le Bengale occidental ont provoqué des déplacements massifs de population, en particulier dans les districts ruraux à faibles revenus.
La vague de chaleur printanière de 2022 a été l'une des plus sévères jamais enregistrées. Elle est arrivée tôt, dès le mois de mars, et s'est prolongée jusqu'en mai, cuisant les États du nord et du centre avec des températures dépassant 47 °C. À Delhi, la température maximale a atteint 49,2 °C en mai, la plus élevée jamais enregistrée pour ce mois. Des études scientifiques ont montré que cet événement extrême était 30 fois plus probable en raison du changement climatique induit par l'homme. La chaleur torride a dévasté les cultures de blé dans le Pendjab, l'Haryana et l'Uttar Pradesh, réduisant les rendements nationaux de 10 à 15 % et obligeant l'Inde à imposer une interdiction temporaire des exportations de blé, une mesure alarmante en cette période d'insécurité alimentaire mondiale.
Les plaines de l'Indus et du Gange, le grenier de l'Inde, sont confrontées à une double crise. D'un côté, il y a les précipitations excessives et l'épuisement des nappes phréatiques ; de l'autre, le stress thermique croissant. Les ouvriers agricoles, en particulier les femmes, déclarent désormais devoir se lever à 4 heures du matin pour terminer les travaux des champs avant que la chaleur insupportable de midi ne s'installe. Des études montrent que l'Inde a déjà perdu plus de 267 milliards d'heures de travail potentielles entre 2001 et 2020 en raison de l'exposition à la chaleur.

Mais la chaleur n'est pas la seule menace. La mousson, autrefois un phénomène saisonnier relativement prévisible, est devenue plus irrégulière. En 2023 et 2024, des États comme l'Himachal Pradesh, l'Uttarakhand et le Sikkim ont subi des glissements de terrain meurtriers et des inondations causées par le débordement de lacs glaciaires, qui ont fait des centaines de victimes. Dans le même temps, certaines régions du Rajasthan et du Maharashtra ont connu de longues périodes de sécheresse suivies de pluies torrentielles qui ont provoqué des crues soudaines. Des villes comme Mumbai et Chennai sont devenues des exemples de « trop d'eau, trop rapidement », submergeant les systèmes de drainage et déplaçant des dizaines de milliers de personnes.
Dans la ville basse de Cooch Behar, dans l'État du Bengale occidental, Arif, douze ans, tenait la main de sa petite sœur tandis qu'ils regardaient la rivière Torsa engloutir leur maison. La mousson était arrivée avec une violence inédite depuis des décennies. Les inondations n'étaient pas seulement importantes, elles étaient soudaines, meurtrières et implacables. Les routes ont disparu en quelques minutes. Les écoles se sont transformées en refuges pour les réfugiés. Les récoltes ont été emportées.
L'océan Indien se réchauffe, augmentant l'évaporation et l'humidité atmosphérique. La mousson désormais est loin d'être un rythme saisonnier doux : c'est une bête imprévisible et violente.
Les régions côtières sont également assiégées. Dans l'Odisha et le Bengale occidental, l'intrusion d'eau salée détruit les rizières. Les mangroves des Sundarbans du côté indien reculent rapidement, entraînant non seulement une perte de biodiversité, mais aussi une perte de patrimoine culturel et de protection naturelle contre les tempêtes. Les cyclones comme Amphan (2020), Yaas (2021) et Mocha (2023) illustrent la puissance croissante des tempêtes dans le golfe du Bengale dans un climat qui se réchauffe.
Le profil énergétique de l'Inde complique le tableau. D'un côté, le pays est devenu un leader dans le déploiement des énergies renouvelables, se classant parmi les cinq premiers au monde en termes de capacité solaire et éolienne. De l'autre, le charbon continue d'alimenter plus de 70 % de son électricité. Lors des vagues de chaleur de 2022 et 2024, la demande en électricité a atteint des sommets tels que le gouvernement a réactivé des centrales à charbon inutilisées pour éviter les coupures de courant, soulignant ainsi la contradiction entre la sécurité énergétique à court terme et la durabilité à long terme.
Il y a toutefois des raisons d'être prudemment optimiste. Le plan d'action national de l'Inde sur le changement climatique comprend des missions sur l'énergie solaire, l'agriculture durable et la conservation de l'eau.
Des programmes tels que Jal Shakti (pour les eaux souterraines) et le programme PM-KUSUM (pompes solaires pour les agriculteurs) renforcent la résilience locale. Mais les experts avertissent que si l'adaptation n'est pas accompagnée de mesures d'atténuation ambitieuses, soutenues par un financement international pour le climat, l'ampleur de la vulnérabilité de l'Inde pourrait bientôt submerger ses systèmes.
4. Bangladesh : le delta qui s'enfonce
Non loin en aval, à Kurigram, au Bangladesh, Meena se tenait debout, immergée jusqu'à la taille, essayant de récupérer ses ustensiles de cuisine. Sa hutte n'avait pas résisté à la fureur du Brahmapoutre.
Le Bangladesh, qui compte plus de 160 millions d'habitants, est situé sur l'un des deltas les plus vulnérables au changement climatique au monde. Plus de 20 % de son territoire pourrait être submergé d'ici 2050 en raison de l'élévation du niveau de la mer et des inondations causées par la mousson. Il est confronté à une série croissante de chocs environnementaux : inondations, cyclones, élévation du niveau de la mer et salinisation.
Selon les projections pour 2023, les précipitations extrêmes dans le nord-est du Bangladesh devraient augmenter jusqu'à un maximum de 100 mm par jour d'ici la fin du siècle dans le cadre de scénarios à fortes émissions. Les projections relatives aux ondes de tempête indiquent une augmentation de 3,5 m à plus de 5,4 m d'ici la fin du siècle.
Dans le sud-ouest, l'élévation du niveau de la mer et l'intrusion d'eau salée détruisent les aquifères d'eau douce et les terres arables. Les rendements rizicoles côtiers ont fortement chuté et les populations de poissons d'eau douce, autrefois essentielles à l'apport en protéines, s'effondrent. La célèbre forêt de mangroves des Sundarbans, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et tampon naturel crucial, est menacée par l'intrusion d'eau salée et l'érosion cyclonique. Ces mangroves, qui absorbaient autrefois l'énergie des tempêtes et stockaient d'immenses quantités de carbone, se fragmentent aujourd'hui à un rythme alarmant.
Malgré ces défis, le Bangladesh est en train de s'imposer comme un leader mondial en matière d'adaptation au changement climatique.
Le gouvernement a mis en place des systèmes communautaires d'alerte aux inondations, des logements surélevés et des infrastructures résistantes au climat, ainsi que des zones de retrait contrôlées. Il a également créé le Fonds fiduciaire pour le changement climatique, l'un des premiers du genre dans les pays en développement. Cependant, d'énormes lacunes subsistent. En 2025, moins de 10 % des projets d'adaptation au changement climatique au Bangladesh seront entièrement financés. Sans un soutien financier international rapide et une réduction des émissions par les pays riches, la résilience du pays pourrait ne pas résister aux vagues à venir.
5. Chine : Quand le ciel se déchaîne
À Zhengzhou, en Chine, Liu Wen, 58 ans, se souvient des inondations de 2021, mais la tempête de 2025 a été pire. Les tunnels du métro se sont transformés en rivières. Les voitures flottaient comme des jouets. Le fleuve Jaune a débordé de son lit sans avertissement.
La mousson d'Asie de l'Est s'était intensifiée, sous l'effet du réchauffement des océans, de la perturbation des courants atmosphériques et de la disparition des masses neigeuses. Zhengzhou a reçu plus de 200 mm de pluie en une seule heure, bien au-delà des moyennes historiques.
La Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, se trouve de plus en plus vulnérable aux phénomènes climatiques extrêmes qu'elle a contribué à accélérer. En 2021, la ville de Zhengzhou a été submergée par un déluge soudain, avec plus de 200 mm de pluie en une seule heure, inondant les tunnels du métro, bloquant des milliers de personnes et faisant des dizaines de victimes. La tempête de 2025 a été encore plus grave, mettant en évidence le décalage mortel entre l'urbanisation rapide et la résilience climatique. Alors que les villes s'étendent verticalement et que les infrastructures sont mises à rude épreuve par la croissance démographique, les systèmes de drainage, les espaces verts et les mesures d'atténuation de la chaleur sont souvent à la traîne.
Au niveau national, la Chine s'est engagée à atteindre son pic d'émissions de carbone avant 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Elle est le leader mondial en matière d'investissements dans les énergies renouvelables, représentant près de la moitié de la croissance mondiale de la capacité solaire et éolienne depuis 2022. Pourtant, paradoxalement, elle continue d'approuver de nouvelles centrales à charbon, sapant ainsi les efforts mondiaux visant à limiter le réchauffement à 1,5 °C. Les analystes affirment que si la Chine ne supprime pas complètement le charbon d'ici 2040, il sera pratiquement impossible de rester dans les limites d'un seuil climatique sûr.
Parallèlement, les menaces climatiques qui pèsent sur l'agriculture et la sécurité hydrique s'intensifient. Les sécheresses qui ont frappé le bassin du Yangtsé en 2022 ont perturbé la production hydroélectrique et les cycles agricoles, tandis que les typhons se sont intensifiés sur la côte est. Le gouvernement a mis en place des « villes éponges » pour absorber les précipitations et atténuer les inondations, mais étendre ces solutions à des milliers de zones urbaines reste un défi colossal.
Les choix de la Chine détermineront non seulement son propre avenir, mais aussi celui de la planète.
6. Une seule planète, une seule crise
Javier, Adèle, Arif, Meena et Liu Wen ne sont pas des cas isolés. Ils sont les symptômes d'une fièvre mondiale déclenchée par des décennies d'émissions de gaz à effet de serre, de déforestation et d'industrialisation effrénée.
Leurs récits font écho à une vérité commune : le changement climatique n'est pas une menace future, c'est une réalité vécue, qui s'intensifie à travers les continents. Chaque inondation, chaque incendie, chaque vague de chaleur s'inscrit dans un schéma mondial façonné par des décennies de combustion de matières fossiles, de déforestation et de croissance non soutenable. La planète se réchauffe, et ce sont les plus vulnérables qui en souffrent en premier et le plus durement. La crise révèle également notre interdépendance. Les émissions dans une région déterminent les catastrophes dans une autre. Les réponses doivent être aussi harmonisées.
Partout dans le monde, les communautés réagissent : panneaux solaires dans les villages, replantation de mangroves le long des côtes, systèmes d'alerte précoce dans les plaines inondables. Mais la résilience seule ne suffit pas. Sans réductions drastiques des émissions, sans financement équitable de l'adaptation et sans transition juste, ce qu’on appelle « adaptation » n’est plus qu’ un lent recul. Il ne s'agit pas seulement d'un test pour la science ou l'économie, mais d'un test pour la volonté collective de l'humanité.
Nous devons mettre fin aux combustibles fossiles, une fois pour toutes.
La justice doit être proclamée immédiatement. Levons-nous sous la bannière de la solidarité. Comme le prévenait le bulletin scolaire d'Arif, « l'eau n'attend pas ». Nous ne devons pas attendre non plus.
Sources & Références
Francis & Vavrus (2015). Geophysical Research Letters.
IPCC AR6 WGII (2022)
Nature (2021). Zhengzhou case study
World Bank (2021). Bangladesh Climate Report
IITM (2022). Rainfall and Monsoon Trends
Euronews Green (2025)
Texas Tribune & Houston Chronicle (July 2025)
Migration Policy Institute (2023)
CarbonBrief & Guardian (2023–2025)








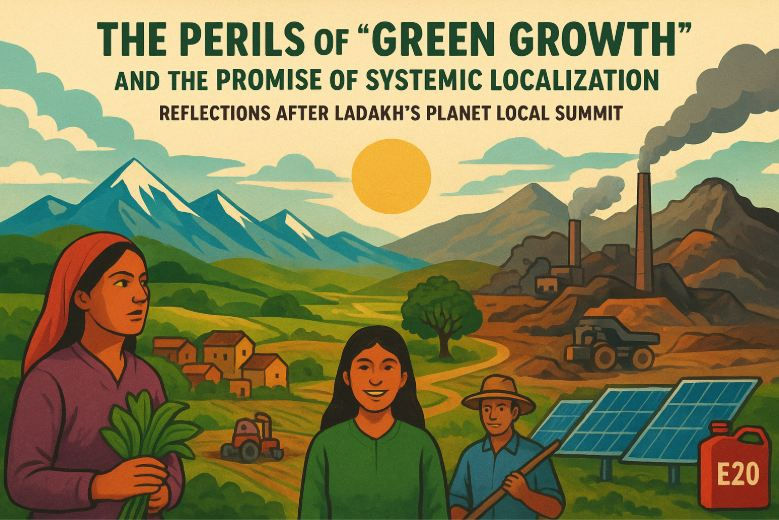
Commentaires